 Prix degressif
Prix degressif





En ce moment, choisissez votre cadeau dans votre panier dès 79€ !
Autour du rucher Conseils en apiculture L'actu des apiculteurs La vie de la ruche Les trésors de la ruche Matériel apicole

Le mois de mars marque un tournant pour les colonies d’abeilles. Les jours s’allongent, les températures deviennent plus clémentes et la nature reprend vie. Avec ces conditions plus favorables, l’activité des ruches s’intensifie : la reine augmente sa ponte, les butineuses reprennent leurs sorties, et la consommation de nourriture s’accroît pour soutenir le développement du couvain.
Pour l’apiculteur, mars est une période cruciale qui demande observation et vigilance. La colonie reste fragile après l’hiver et un manque de ressources ou une maladie non détectée peut compromettre sa reprise. Il est donc essentiel de surveiller la dynamique du rucher, d’assurer un bon état sanitaire et d’intervenir avec précaution pour accompagner la colonie vers une saison productive.
Avec l’arrivée du printemps, l’ensemble de la colonie retrouve une activité plus soutenue. Les abeilles doivent reconstruire leur population, stocker des provisions et entretenir leur habitat.
En réponse à l’augmentation de la température et à la disponibilité croissante de pollen, la reine intensifie sa ponte. En pleine activité, elle peut pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour, assurant ainsi le renouvellement et l’agrandissement de la colonie.
Le développement du couvain nécessite des quantités importantes de pollen et de miel, car les larves ont besoin d’une alimentation riche pour devenir de futures ouvrières robustes. L’apiculteur doit donc veiller à ce que les réserves soient suffisantes pour ne pas freiner la croissance de la colonie.
Avec des températures dépassant 12-14°C, les butineuses reprennent leurs vols à la recherche des ressources indispensables à la ruche. Elles collectent principalement :
Plus la diversité florale est importante autour du rucher, plus la reprise est facilitée. Les apiculteurs doivent donc s’assurer que les butineuses disposent d’un accès rapide à des plantes mellifères, sans quoi les colonies risquent de s’affaiblir.
Avec la reprise de la ponte et le stockage accru de nectar, les abeilles cirières (âgées de 12 à 18 jours) entrent en action. Elles commencent à sécréter de la cire pour bâtir de nouveaux rayons et réparer les alvéoles usées.
Produire 1 kg de cire représente un coût énergétique considérable, nécessitant entre 8 et 10 kg de miel. Une ruche en pleine croissance peut produire entre 500 g et 1 kg de cire par saison, selon ses besoins.
L’apiculteur doit donc veiller à :
Un bon renouvellement des rayons favorise un couvain sain et une meilleure organisation des provisions pour la colonie.
Mars marque le retour des interventions majeures dans le rucher. La première visite de printemps permet d’évaluer la vitalité des colonies, l’état du couvain, les réserves alimentaires et l’hygiène des ruches. Une inspection attentive et méthodique est essentielle pour assurer un bon développement de la colonie.
La visite de printemps ne doit être effectuée que lorsque les conditions sont favorables, sous peine de compromettre la survie du couvain.
L’état du couvain est un indicateur clé de la santé de la colonie. Un bon couvain doit être dense, compact et homogène, signe d’une reine active et en bonne santé.
Un bon suivi du couvain dès mars garantit une montée en puissance optimale pour la saison à venir.
Avec l’augmentation de la ponte, la consommation de miel et de pollen s’accélère. Une colonie active peut consommer entre 1 et 2 kg de miel par semaine en mars, selon la météo et la disponibilité des ressources extérieures.
Le renouvellement progressif des cadres est primordial pour l’hygiène et la santé des abeilles.
Une cire propre favorise une meilleure ponte de la reine et un développement harmonieux de la colonie.
Le plateau de fond de ruche accumule des débris de cire, des excréments et parfois des parasites, constituant un foyer potentiel de maladies.
Un fond propre améliore l’hygiène du rucher et réduit la prolifération des parasites comme le varroa.
Le bon développement des colonies ne dépend pas seulement de la ruche elle-même, mais aussi de son environnement immédiat. Un rucher bien entretenu limite les risques sanitaires et optimise l’activité des abeilles.
Un rucher négligé favorise l’humidité et attire les nuisibles. Il est donc essentiel de :
Un environnement propre et dégagé facilite le travail des abeilles et limite les problèmes sanitaires.
Avec la montée en activité de la colonie, l’accès à une source d’eau fiable devient essentiel. Les abeilles utilisent l’eau pour :
Pour garantir une hydratation optimale aux abeilles :
Un abreuvoir bien placé et entretenu permet de réduire les trajets des butineuses et d’éviter qu’elles ne se dirigent vers des sources d’eau contaminées.
Avec la reprise de l’activité au sein de la ruche, les risques sanitaires augmentent. L’apiculteur doit rester vigilant et prévenir les maladies avant qu’elles ne se propagent. Deux points essentiels sont à surveiller : le varroa et l’équilibre nutritionnel des abeilles.
Le varroa destructor est le principal parasite des colonies d’abeilles. Invisible à l’œil nu en début d’infestation, il peut causer de lourds dégâts s’il n’est pas détecté à temps.
Une lutte précoce contre le varroa permet d’éviter une explosion parasitaire en pleine saison apicole et de protéger la vitalité de la colonie.
Au printemps, les besoins nutritionnels de la colonie augmentent avec la croissance du couvain. Un manque de pollen peut entraîner un affaiblissement des larves et des nourrices, réduisant ainsi le développement global de la colonie.
Un bon équilibre alimentaire garantit une ponte optimale et une colonie en pleine santé pour les miellées à venir.
Le frelon asiatique (Vespa velutina) est un prédateur redoutable pour les abeilles. Dès mars, les reines fondatrices sortent d’hibernation et commencent à établir de nouveaux nids. Un piégeage précoce permet de réduire la menace avant l’été et de limiter la pression sur les ruches.
Une intervention préventive permet d’éviter des pertes importantes plus tard dans la saison.
Positionner les pièges stratégiquement :
Utiliser un appât efficace pour capturer sélectivement les frelons :
Astuce : Vérifier les pièges régulièrement pour éviter de capturer d’autres insectes utiles et retirer les frelons piégés.
Un piégeage efficace dès mars permet de limiter la prolifération des frelons asiatiques, et ainsi de protéger durablement les colonies d’abeilles tout au long de la saison apicole.
L’élevage de reines est une pratique qui permet d’optimiser son cheptel en sélectionnant des lignées vigoureuses et adaptées à son environnement. Contrairement aux idées reçues, elle n’est pas réservée aux professionnels : même un apiculteur amateur possédant quelques ruches peut l’envisager.
En renouvelant régulièrement ses reines, l’apiculteur garantit une colonie dynamique, productive et résistante aux maladies. Mars est une période idéale pour anticiper cet élevage et organiser les premières étapes.
L’élevage de reines demande de l’anticipation et de l’observation : en sélectionnant soigneusement les colonies-mères, l’apiculteur favorise un cheptel plus résistant et mieux adapté aux conditions locales.
En prenant le temps de bien préparer son élevage dès mars, l’apiculteur s’assure d’avoir des reines de qualité au bon moment, renforçant ainsi la vitalité de son rucher.
 Prix degressif
Prix degressif











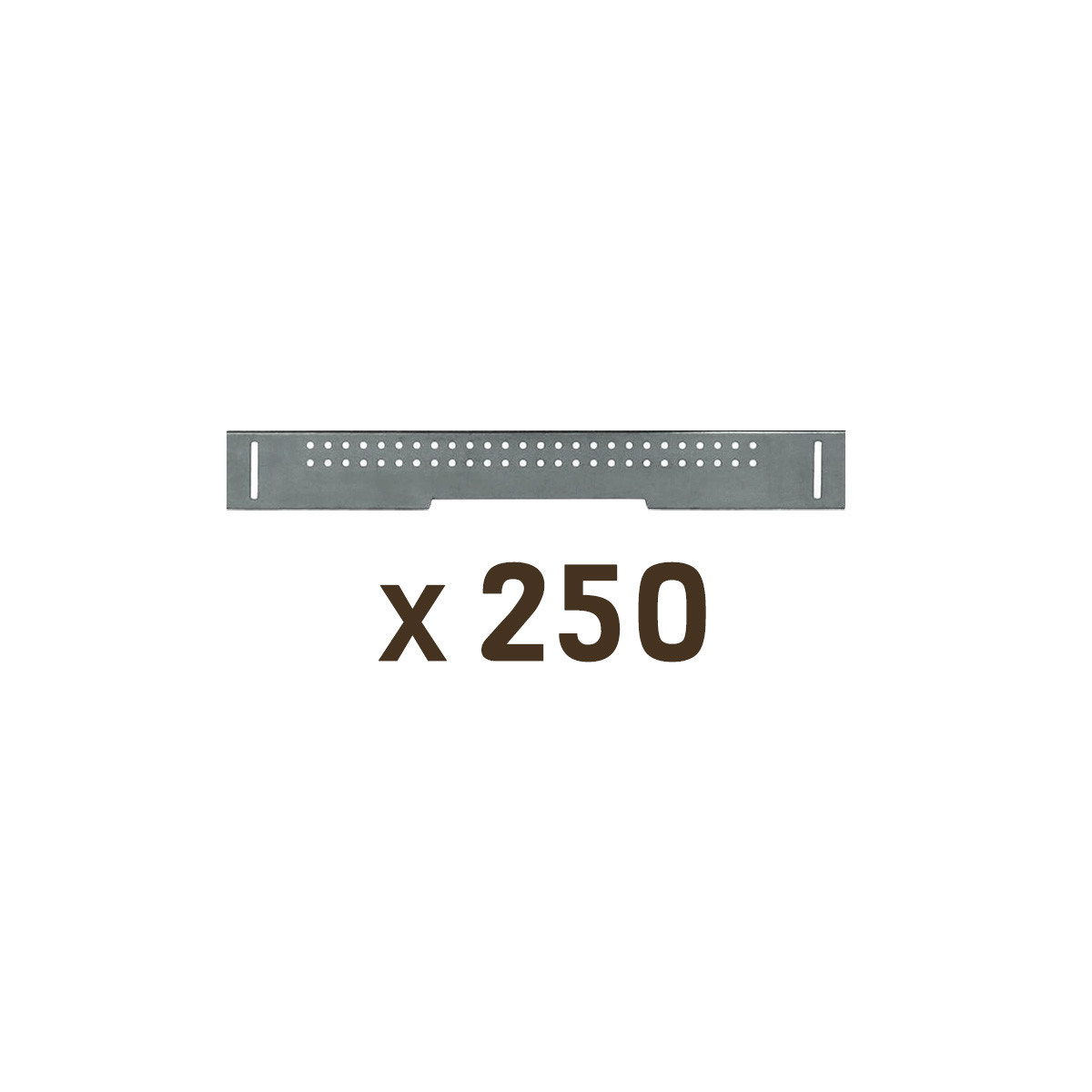






 Prix degressif
Prix degressif

Le printemps est bientôt là, la visite permet de faire le bilan des ruches et d'inspecter son rucher et ses c [...]
Depuis toujours, les apiculteurs cherchent à conserver leurs ruchers d'une saison à l'autre. Pour ce faire, la p [...]
Le candi est une solution essentielle pour nourrir les abeilles en hiver. Découvrez comment le fabriquer maison, [...]